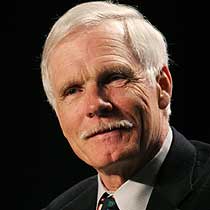LA MICROFINANCE RISQUE DE RENIER SON INSPIRATION HUMANISTE
L’année mondiale de la microfinance en 2005 a provoqué une unanimité de façade. Au delà de la dévotion naïve exprimée par de trop nombreux médias, des incidents récents montrent qu’on ne dispose pas, aujourd’hui, d’appareils méthodologiques robustes et consensuels pour prouver que les avantages de tel ou tel système sont nettement supérieurs à ses impacts négatifs. On sait pourtant que l’action de la microfinance devient négative dans des circonstances bien précises, comme on pouvait le lire, par exemple, dans un article au ton brutal d’Isabelle Guérin et Marc Roesh paru dans Le Monde du 29 novembre 2005. La question des performances sociales de la microfinance est d’autant plus cruciale que l’influence des marchés financiers devient dominante dans ce domaine, après des décennies d’influence des ONG et des financements par l’aide publique. Une évaluation de cet aspect de la microfinance est alors nécessaire. Mais ceci provoque des réactions vives, dont voici quelques brefs exemples.
Un faux problème ?
Au cours de cette fameuse année 2005, les publications se sont multipliées : du coté des grands bailleurs, il fallait montrer que le consensus régnait. C’est peut-être cela qui a alimenté la violence du ton de l’article d’un certain Marc Jacquand, Programme Manager des Fonds d’Equipement des Nations Unies (FENU), « Measuring Social Performance : The Wrong Priority », paru dans le magazine en ligne Microfinance Matters en août 05. M. Jacquand cite le « Livre rose » du Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP), un guide destiné aux bailleurs selon lequel les institutions de microfinance (IMF) doivent produire une information standardisée et « permettant la comparaison des performances financières ainsi que sur les performances sociales » des IMF.
[Qu'est ce que le CGAP ? cliquez ici]
Mais il suggère de ne pas aller plus loin dans la mesure des impacts, car le lien causal entre les prêts et le succès des IMF est trop difficile à établir. Mais surtout, écrit-il, ne risquons-nous pas « de ghettoïser la microfinance en mettant l’accent sur les performances sociales », alors qu’il existe un consensus pour dire que « la microfinance doit entièrement s’intégrer dans les systèmes financiers nationaux et internationaux » ? Et d’ailleurs, quand on enquête sur ceux qui demandent que l’on améliore l’information sociale, « en fonction de votre degré de cynisme », on s’aperçoit que ce sont « des consultants et des équipes de recherche [qui cherchent à] justifier leur propre existence ».
Bref, résume-t-il, dans un contexte de « ressources limitées », « attirer notre attention et notre argent pour mesurer des performances sociales mal définies est une fausse priorité». Un peu plus tard, le 4 novembre 2005, le quotidien suisse l’agefi, qui est très lu dans les milieux financiers francophones, publiait une « réflexion » d’un rédacteur en chef, Christophe Roulet, intitulée « La microfinance et les études des cas ». L’article commence sur un ton ironique: l’Université de Genève et le Bureau International du Travail (BIT), après avoir examiné une cinquantaine d’IMF, concluent « que la grande majorité ont du mal à atteindre le seuil de rentabilité. Quelle nouvelle ! ». Alors que certaines IMF commencent à trouver des relais « sur le marché des capitaux », « le plus affligeant, […] c’est qu’on arrive à dégager des fonds pour financer une recherche académique qui ne sert strictement à rien », affirme le journaliste. D’ailleurs « initier une étude concluant [que les IMF] ont de la peine à être rentables est non seulement une imbécillité dans son principe, mais elle porte outrage à tous ceux qui luttent pour prouver le contraire ». Ces deux exemples ne sont pas de simples anecdotes. Les personnes qui s’expriment ainsi ont des responsabilités vis à existence »). C’est pourquoi il faut considérer ce type de discours comme un symptôme, sans doute celui d’une angoisse diffuse. Le consensus humaniste ne suffit plus
Attirer les bailleurs privés
Car, l’autre effet de l’Année mondiale de la microfinance est de confirmer aux grandes banques internationales et aux gérants de capitaux que le secteur de la microfinance peut devenir un investissement rentable. Les recommandations du CGAP de ces dernières décennies ont toujours été univoques : les IMF doivent, avant tout, « se libérer » des subventions publiques. Ce sont les principes édictés dans un court guide, Donor Guidelines for Microfinance International Best Practice, du Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development, qui figure sur le site du FENU.
Les résultats seraient certains : « des expériences internationales montrent que les meilleures IMF ont atteint leur efficacité opérationnelle en 3 à 7 ans, et leur autosuffisance financière (c’est à dire la couverture de la totalité de leurs coûts financiers par des taux d’intérêt non-bonifiés) en 5 à 10 ans », ce qui est vivement contesté par de nombreuses organisations. Elizabeth Littelfield, directrice du CGAP, admettait elle-même en 2004 que sur 7000 IMF, « une centaine sont déjà pérennes, c’est à dire qu’elles pourraient fonctionner et être rentables sans subventions des bailleurs de fonds en ayant recours au marché des capitaux » (Le Monde du 28 mai 2004). Ainsi, on se souviendrade 2005 aussi comme l’année charnière. La microfinance dominante passe désormais sous l’influence des grands bailleurs privés, alliés à des banques et d’autres institutions financières internationales, privées également. Le champ de la microfinance devient une partie de la R&D, du marketing innovant, de l’expansion géographique de ces institutions.
De nouveaux marchés pour les banques
Les domaines d’investissement des banques, régulièrement décrits sur le site MicroCapital (« the candid voice for microfinance investment »), sont trois :
1. Pour les grandes banques de détail, leur implication dans la microfinance est une façon d’explorer de nouveaux marchés. Citi Group, ABN Amro ou Barclays « recherchent une exposition directe ou indirecte sur ces marchés de la microfinance, pour une raison simple : il y a de l’argent à se faire », y a-t-il écrit sur le site. Plus largement, dans son dernier rapport annuel, Citi Group explique que c’est également une façon de remplir ses obligations en termes de responsabilité sociale. Mais il s’agit aussi d’« aider » les activités du secteur informel à se développer en direction du secteur formel, en créant au passage de meilleurs clients, c’est-à-dire des clients plus sûrs pour les banques.
2. Les grandes banques de détail ont également besoin de tester de nouveaux outils sur de nouveaux marchés : par exemple des méthodes de scoring individualisés, qui abaisseraient sensiblement les coûts de transaction, puisque ceux des IMF sont réputés élevés.
C’est un début de contamination des prêts professionnels, qui reposent sur la qualité d’un projet, par les techniques des prêts à la consommation, les scorings personnels. On sait pourtant que ces techniques, mal utilisées, ont été à l’origine de la grave crise financière dans plusieurs pays d’Amérique latine, qui culminait au Pérou et en Colombie en 2000.
3. Enfin, plus globalement, le monde développé regorge d’épargne, et les gérants constatent que les rendements y sont et resteront bas, alors que les pays émergents offrent des perspectives de rendements élevés. La tentation est alors forte de
confier des capitaux à des IMF « matures », tout en promettant des rendements élevés aux souscripteurs que sont les fonds de retraite anglo-saxons, comme le font par exemple Blue Orchard et Morgan Stanley.
L'intégralité de l'article ici
------------------------------
Qu'en pensez vous ? Il y a t'il eu un phénomène de dévotion massive des médias à l'égard de la microfinance ?